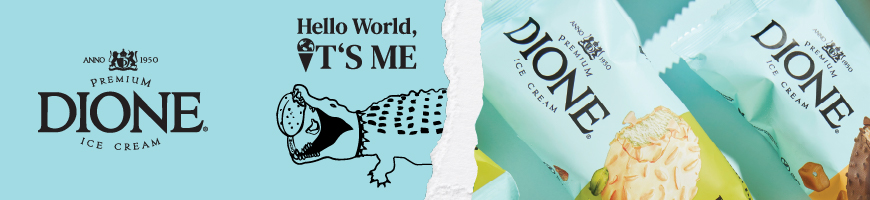Géraldine Hennequin
Loin des postures classiques et des jeux politiques traditionnels, Géraldine Hennequin défend une parole franche, un engagement enraciné dans le réel et une foi intacte dans les vertus d’une démocratie revivifiée. La leader d’Idéal Démocrates réaffirme un idéal de renouvellement, porté par la conviction que la politique doit avant tout servir l’intérêt général.
Sa lecture de l’actualité témoigne de la maturité politique d’une femme pour qui l’éthique prime sur la conquête. Un engagement sincère qui, loin d’être terni par les obstacles, se renforce dans la conviction d’un avenir démocratique plus inclusif et plus juste. Rencontre avec une femme de convictions et de valeurs.
✍ Axelle GAILLARD
📷 Brady GOORAPPA
Sept mois après les législatives et à peine quelques semaines après les municipales, les premières fissures apparaissent entre le gouvernement et son électorat. Comment analysez-vous ce début de mandat sous tension pour l’Alliance du Changement ?
Une immense désillusion pointe déjà le bout du nez. Le pays a voté pour un changement mais, très vite, certaines vieilles habitudes ont repris le dessus. Par exemple, le manque de concertation qui figurait pourtant sur la “top list” de l’alliance. Les premiers faux pas augurent les premières fractures. C’est inévitable.
Le pouvoir concentré dans les mains d’une seule équipe ne doit jamais être perçu comme un chèque en blanc. Cette confiance accordée par les citoyens est un mandat fragile, qu’il faut sans cesse mériter. Chaque faux pas, chaque décision prise sans dialogue, est ressenti comme un signe de mépris par un électorat de plus en plus vigilant. C’est précisément pour cela qu’une nouvelle génération de politiques est appelée à émerger : celle qui saura replacer l’humain et l’écoute au cœur de l’action, et redonner à la démocratie sa force et sa dignité.
Le dernier budget fait grand bruit, notamment la réforme des retraites, qui a vu la levée de boucliers de la population, des syndicalistes, mais aussi des dirigeants d’hier. On ne vous a pas entendue sur cette mesure qui secoue le gouvernement ?
Je ne me suis pas tue par choix, mais par exigence de compréhension. Cette mesure est budgétaire avant d’être sociale. Elle souffre d’un manque de consensus et de pédagogie. Oui, la réforme des retraites est devenue inévitable au regard de l’explosion de la dette laissée par le précédent gouvernement. Mais ce n’est pas parce qu’elle est nécessaire qu’on peut la faire passer en force, sans dialogue, sans un minimum de débat démocratique. Ce qui m’a choquée, c’est la brutalité de la méthode.
Quand on réforme à ce point la vie des gens, on consulte, on explique, on écoute… Là, il a fallu que le Premier ministre vienne éteindre l’incendie en urgence, corriger ses annonces, revoir les modalités. On ne joue pas avec la vie des travailleurs, surtout ceux qui ont des métiers pénibles. On ne leur demande pas de rajouter des années d’usure à leur corps, comme si de rien n’était. Et puis il faut arrêter de copier-coller les modèles étrangers. À Maurice, on commence souvent à travailler jeune, on vit moins longtemps, on s’use plus vite. Et que dire des petits métiers, des auto-entrepreneurs, des femmes en emploi discontinus ? Ils sont invisibles dans cette réforme.
Il est évident que les finances publiques doivent être assainies. Mais alors qu’on commence par balayer devant sa porte : où sont les coupes dans les dépenses démesurées de l’État ? Les rapports d’audit s’accumulent et les gaspillages continuent. On ne peut pas faire payer l’addition aux plus fragiles pendant que l’appareil d’État reste intouchable.
Je voudrais, par ailleurs, souligner que cette pseudo indignation soudaine de l’ancien régime, qui s’est joint aux manifestants le 21 juin, est généreusement indécente. Personne n’oublie qu’ils ont été les fossoyeurs de notre système social et économique !
La trajectoire budgétaire et la controverse sur l’âge de la retraite traduisent donc, selon vous, une fracture dans le contrat social ?
La fracture sociale, elle ne date pas d’hier. Elle est là depuis des lustres. Ce n’est pas le nouveau gouvernement qui l’a créée, mais c’est à lui que revient la responsabilité de commencer à la réparer. Et c’était d’ailleurs l’engagement qu’il avait pris : rétablir la confiance. Or, aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’on s’en éloigne dangereusement.
La confiance ne se décrète pas, elle se construit, par les actes. Or partout, j’entends la même colère monter chez les travailleurs : pourquoi demander toujours plus d’efforts à ceux qui peinent, pendant que les privilèges politiques restent intacts ? La question des salaires et des avantages des ministres et députés revient sans cesse. Bien sûr, réduire les indemnités parlementaires ne comblera pas la dette publique. Mais sur le plan symbolique, cela voudrait dire quelque chose. Pourquoi, par exemple, un député touche-t-il une pension à vie dès son deuxième mandat, alors qu’un ouvrier doit cotiser toute sa vie pour mériter une retraite à taux plein ? Ce n’est pas seulement injuste. C’est inacceptable. Un député, comme n’importe quel citoyen, devrait avoir une retraite proportionnelle à son temps de mandat, et la toucher à l’âge légal, pas avant. C’est ça, la justice sociale. Ce sont des gestes symboliques, oui, mais les symboles comptent quand on gouverne un pays fracturé.
Le secteur des arts et de la culture vous est cher. Comment analysez-vous que ce secteur soit le grand oublié du budget de ce gouvernement ?
C’est une erreur stratégique. La culture n’est pas un luxe, c’est un levier de cohésion, d’émancipation, d’économie… Oublier la culture dans un moment de crise, c’est affaiblir notre capacité à créer du lien. Les artistes mauriciens ont prouvé leur résilience, leur inventivité. Mais sans soutien structurant, ils s’épuisent. On ne peut pas bâtir une nation moderne sans porter sa mémoire, sa langue, sa créativité. Et surtout, on oublie trop souvent une chose essentielle : derrière chaque création, chaque scène, chaque exposition, il y a des femmes et des hommes qui vivent de ce métier. Techniciens, artistes, auteurs, producteurs… Que leur dit-on aujourd’hui en les rayant du budget ? Qu’ils ne comptent pas ? Que leur travail n’a pas de valeur ?
Pourquoi est-ce que les gouvernements successifs ne se sont jamais réellement intéressés aux arts et au patrimoine de notre pays ?
Les arts et la culture ne sont pas un supplément d’âme. Ce sont des secteurs économiques à part entière. À l’échelle mondiale, les industries culturelles et créatives représentent plus de 3 % du PIB et près de 30 millions d’emplois selon l’UNESCO. En Afrique, on estime que l’économie créative pourrait générer près de 20 millions d’emplois d’ici 2030. À Maurice, malgré l’absence de chiffres, le potentiel est réel mais inexploité.
On attend trop souvent de la culture qu’elle se finance seule, ou qu’elle serve de vitrine ponctuelle. Or, sans écosystème structurant, aucun secteur ne peut se développer. Il faut une politique culturelle ambitieuse, mais aussi des conditions de travail stables, des dispositifs de soutien à la création, à la diffusion, à la formation.
Et le patrimoine reste le grand perdant ?
Parce que le patrimoine ne rapporte pas à court terme. Et parce qu’il dérange : il rappelle l’histoire, les luttes, les fractures. C’est plus facile de construire du neuf que de réhabiliter l’ancien. Mais c’est une erreur politique. Préserver le bâti, c’est investir dans l’économie locale, le tourisme responsable, la mémoire collective. Il faut arrêter de penser que notre passé est un fardeau : c’est une richesse. Notre patrimoine, c’est notre fierté collective. Il faut un plan national de sauvetage, mais surtout une politique cohérente.
Revenons à la politique et aux alliances. Comment espérez-vous changer quoi que ce soit quand on voit qu’un parti d’extrême gauche comme Rezistans ek Alternativ, qui est aujourd’hui un partenaire de l’alliance au pouvoir, avale couleuvre après couleuvre ?
Les opportunités politiques ne doivent jamais devenir des compromissions. Gouverner ensemble n’a de sens que si l’on porte un projet commun, clair et assumé. Sinon, on sacrifie les promesses de réforme de notre démocratie sur l’autel des équilibres de pouvoir. Je respecte l’histoire militante de Rezistans ek Alternativ, mais il ne suffit pas d’entrer dans un gouvernement pour le changer : encore faut-il garder sa voix, ses valeurs, sa cohérence. Être député, ce n’est pas être soumis à la ligne d’un exécutif, c’est d’abord être fidèle à la parole donnée à ses électeurs. Il n’y a rien de subversif là-dedans. C’est une exigence démocratique.
Quand les convictions se taisent au nom du compromis permanent, c’est la politique qui se vide de son sens. C’est la tragédie des alliances de circonstance.
La jeunesse semble de plus en plus désabusée par la politique. Comment entendez-vous mobiliser et redonner confiance à cette génération ?
En cessant de leur parler de haut. En les écoutant. En leur confiant de vraies responsabilités. La jeunesse mauricienne n’est pas désintéressée : elle est exigeante, lucide, impatiente ! Il faut ouvrir les portes, simplifier l’accès aux droits, valoriser l’engagement civique et écologique. Et surtout, leur faire sentir que leur voix compte. Ce n’est pas à eux de venir vers nous : c’est à nous d’aller vers eux.
Sur un plan plus personnel, qu’est-ce que ces deux campagnes électorales vous ont appris sur vous-même ?
Elles m’ont d’abord appris l’humilité. Le terrain se conquiert pouce par pouce. Rien n’est jamais acquis. Il faut écouter, convaincre, revenir, parfois douter, mais tenir. Sans prétention, je continue de penser qu’on peut avoir raison trop tôt. Et que dans le vacarme des promesses électorales et des slogans creux, il est encore difficile de faire adhérer à des projets solides, à une parole de vérité. Mais je ne regrette rien. J’ai toujours préféré l’exigence à la facilité.
Sur moi-même, j’ai surtout appris à ne plus confondre illusions et convictions. Et à quel point, en politique, être une femme en position de leadership reste un combat inégal. L’obstacle n’est pas toujours frontal. Il se loge dans les réflexes, dans les regards, même chez les bienveillants. Obtenir l’adhésion quand on est une femme, c’est encore trop souvent devoir en faire deux fois plus pour être prise au sérieux. Mais je tiens. Parce que je crois profondément que la politique doit redevenir un lieu d’intégrité et de courage. Ce n’est pas une ambition personnelle, c’est un engagement de conscience.
Est-ce que les résultats que vous avez obtenus lors des élections municipales remettent en cause votre engagement politique ?
C’était ma première participation à une élection, et je n’ai aucun regret. Avec Idéal Démocrate, nous avons porté seuls notre engagement, sans machine, sans compromis, avec sincérité. Notre objectif, c’était surtout de faire entendre une autre voix, d’ouvrir d’autres avenues possibles pour notre démocratie. Et cela, nous l’avons pleinement atteint.
Alors non, il n’est pas question de renoncement. L’abstention massive lors des municipales ne me décourage pas — elle me confirme qu’il y a urgence à faire autrement. Quand les citoyens se détournent des urnes, ce n’est pas l’indifférence, c’est la défiance. Et cette défiance, elle appelle une réponse, pas une retraite. C’est justement là qu’il faut rester debout, avec une parole claire, une ligne droite, et des actes qui suivent. On ne reconstruit pas la confiance en disparaissant au premier revers.